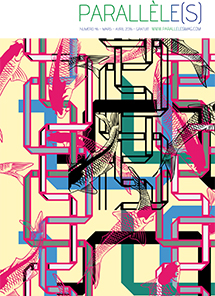FURY
de David Ayer (Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman)

On ne compte plus les chefs-d’oeuvre du film de guerre engendrés par Hollywood, qu’ils soient psychologiques (« CÔTE 465 » d’Anthony Mann, « J’AI VECU L’ENFER DE COREE »), antimilitaristes (« LES NUS ET LES MORTS » de Walsh, « LES SENTIERS DE LA GLOIRE ») ou autres (« MASH » de Robert Altman).
Après le raté « MONUMENTS MEN » (sorti en mars dernier), l’industrie américaine se devait de réagir, pour prouver qu’il ne s’agissait là que d’un accident passager.
C’est pourquoi nous avons droit, aujourd’hui, à « FURY », de David Ayer
1945. En Allemagne, l’avancée des Alliés ne se fait pas sans heurts car, désespéré, Hitler a ordonné à son armée d’enrôler femmes, enfants et tous ceux qui peuvent tenir un fusil. C’est dans ce contexte tendu que Don « Wardaddy » Collier (Pitt), à bord d’un tank blindé, est chargé de diverses missions à haut risque, en plein dans les lignes ennemies. Avec lui, son équipe, trois vieux briscards voulant en découdre, et une nouvelle recrue, Norman (Lerman), qui découvre les atrocités du conflit…
Nous avions déjà parlé de David Ayer, via son précédent long métrage, le pas terrible « SABOTAGE » avec Schwarzenegger.
Homme polyvalent (vu qu’ hormis se trouver derrière la caméra, il est également l’auteur des scénarios qu’il tourne), Ayer démontre un talent technique certain, mais s’exerçant, le plus souvent, au détriment de ses histoires, bancales, nuisant ainsi à l’ensemble.
« END OF WATCH » en était le parfait exemple.
Or, présentement, il n’en est rien.
Réussissant à trouver un bon équilibre entre des personnages existants immédiatement, au mental caractérisé selon les surnoms (Bible, Gordo, Machine) et une narration qui justifie sans cesse leur présence, le soldat David signe un épatant actioner, âpre et violent.
Cette épopée militaire bénéficie d’une superbe photo due à Roman Vasyaniov, jeune chef opérateur habile (« THE EAST »), baignant d’une lumière crue et réaliste ce chemin de croix à l’allure d’oraison funèbre.
Excepté Logan Lerman, l’élément faible, le casting est impeccable : Brad Pitt, hiératique, impressionne et Shia LaBeouf fait preuve de solidité.
On pense parfois au « CROIX DE FER » de Peckinpah de par l’ambiance de certaines séquences dont une, crispante, de repas et l’on n’est pas loin, lors des combats, des comic books de Joe Kubert et Russ Heath.
« FURY », tout en nous embarquant en terrain connu et balisé, arrive à nous surprendre.
Un joli tour de force.
MAGIC IN THE MOONLIGHT
de Woody Allen (Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay Harden)

Nous sommes en 1928. Stanley Crawford, un Anglais arrogant et blasé, devient, lorsqu’il enfile son costume asiatique de mandarin, Wei Ling Soo, le plus célèbre des magiciens de son temps, ravissant le public de ses brillants tours. Peu savent ce secret comme son ami Howard Burkan. Celui-ci lui demande de venir dans le sud de la France pour démasquer Sophie Baker, une prétendue médium, installée, avec sa mère, chez une riche famille. Crawford, ne croyant pas au paranormal et détestant les escrocs, accepte et s’y rend, se faisant passer pour un homme d’affaires…
Je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois, dès les sempiternelles notes de clarinette en début de générique, je ne peux m’empêcher de vouloir prendre mes jambes à mon cou, sachant ce qui va suivre.
Un réflexe pas forcément si bête que ça, confère les foirades que sont « TO ROME WITH LOVE », «MINUIT A PARIS» et un peu, tout de même, « BLUE JASMINE » car, sauf Cate Blanchett, impériale, pas grand chose à sauver de cet amas de clichés.
Le dernier masterpiece de Woody Allen, « MATCH POINT » remonte déjà à 2005.
Même s’il n’est pas totalement réussi, « MAGIC IN THE MOONLIGHT » est agréable, de par ses clins d’oeil à l’ensemble de la carrière du fameux juif new-yorkais.
Colin Firth campe avec saveur le serviteur de sa très gracieuse majesté, cartésien, alter-ego d’Allen, néanmoins pas toujours crédible quant à ses réactions passionnelles, tandis que la délicieuse Emma Stone irradie l’écran. Leur tandem fonctionne plutôt bien.
Les gros défauts sont les rôles secondaires, pas assez consistants, et une intrigue trop convenue.
Un cru moyen mais charmant.
BANDE DE FILLES
de Céline Sciamma (Karidja Touré, Assa Silla, Lindsay Karamoh)

Après nous avoir séduit, voire même ébloui, avec « NAISSANCE DES PIEUVRES » (son meilleur) puis « TOMBOY », voici « BANDE DE FILLES » de Céline Sciamma, qui fit l’ouverture, cette année, de la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes.
Cette ancienne élève de la FEMIS entreprend de nous narrer le quotidien de jeunes Africaines habitant les quartiers en banlieue parisienne.
Marieme, seize ans, tente, jour après jour, de « survivre » dans un environnement pas facile, entre quolibets réguliers des garçons et un frère aîné intransigeant, qui parfois la bat pour la mettre au pas. Croisant sur sa route un trio de « rebelles » mené par Lady, elle décide de profiter de sa jeunesse à fond, quelles qu’en soient les conséquences…
Continuant son exploration du droit à la différence, ici culturelle et civilisationnelle et non plus uniquement sexuelle, Sciamma, tout en évitant un côté militant bête et méchant, dresse un portrait fort de jeunes femmes d’aujourd’hui, transcendé par des comédiennes inconnues, à la présence indéniable, dénichées dans les rues de Paris.
Soumis à des règles tacites liées à leur ethnie, ce « band girl » détonne, entre envie d’émancipation (une superbe scène de playback sur fond de « Diamonds » de Rihanna) et colère intérieure.
Seule légère ombre au tableau, la durée (près de 2 heures) qui laisse transparaître quelques longueurs, surtout dans un dernier acte assez inutile.
Un format plus court aurait été mieux approprié, à l’instar des oeuvres passées de cette cinéaste d’importance.
Il n’en reste pas moins un drame poignant.
ON A MARCHÉ SUR BANGKOK
de Olivier Baroux (Kad Merad, Alice Taglioni, Claude Perron)

Le « buddy movie » (deux héros aux antipodes l’un de l’autre, devant travailler ensemble) à la française existe bel et bien.
C’est Jacques Brel / Lino Ventura pour « L’EMMERDEUR » d’Edouard Molinaro ou encore Pierre Richard / Gérard Depardieu dans les films de Francis Veber.
Généralement, l’association de deux hommes. Plus rarement, curieusement, celle de deux femmes. Alors, un de chaque sexe…
Et pourtant, cette parité se trouve dans « ON A MARCHE SUR BANGKOK », la nouvelle abomination d’Olivier Baroux, un habitué (« MAIS QUI A RE-TUE PAMELA ROSE ? »).
Serge Renart (Merad), reporter TV ayant connu le succès avec des émissions d’investigation, est devenu has-been. Une affaire lui tombe entre les mains, qui pourrait bien le remettre sur le devant de la scène : que s’est-il vraiment passé le 20 juillet 1969, lors de la retransmission télévisuelle du premier homme sur la Lune où, pendant deux minutes, la NASA n’eut plus aucune nouvelle de la mission Apollo 11? Pour résoudre ce mystère, il doit s’associer avec Natacha Bison (Taglioni), une reporter de guerre imprudente. Leur enquête les mènera en Thaïlande…
Gags lourdingues et éculés (un des personnages prétend parler une langue étrangère et évidemment ne dit que des horreurs), acteurs mauvais comme des cochons – Kad Merad est égal à lui même et cette pauvre Alice Taglioni tombe bien bas (même si elle n’a jamais été très haut, non plus) – dialogues indigents, médiocrité des péripéties, cet affligeant pastiche d’ « A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT » de Zemeckis et de « LA CHÈVRE » est, pour tous celles et ceux qui aiment le cinéma populaire français un tant soit peu de qualité, une torture insupportable.
A en faire rougir de honte les bourreaux de Guantánamo.
Le DVD de la semaine : « SIDEWALK STORIES »
de Charles Lane / CARLOTTA
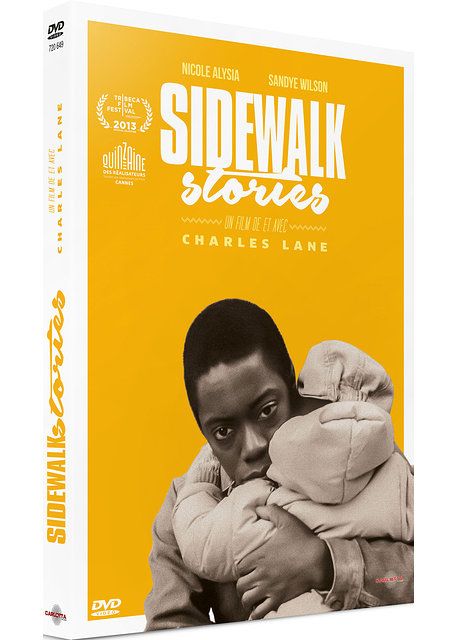
Si l’on vous dit Spike Lee ou Steve McQueen (« 12 YEARS A SLAVE »), vous connaissez par coeur.
Si l’on vous dit Melvin Van Peebles (« SWEET SWEETBACK’S BAADASSSSS SONG »), peut-être un peu moins.
Et si l’on vous dit Charles Lane, alors là…
Heureusement, CARLOTTA vient à la rescousse en proposant un DVD du métrage le plus symptomatique de ce singulier metteur en scène.
Né en 1953 dans le Bronx, cet afro-américain n’eut de cesse d’oeuvrer dans un cinéma social et engagé, depuis ses premiers films en Super 8 étant gamin jusqu’à ses années universitaires. Influencé précocement par Hitchcock, il partage avec le maître du suspense un sens du découpage précis.
Datant de 1989, « SIDEWALK STORIES » est centré autour d’un artiste de rue dont on ne connaîtra jamais le nom, interprété par Lane lui-même, gagnant sa vie en dessinant des passants et résidant dans le sous-sol d’un immeuble délabré. Un soir, témoin du meurtre crapuleux d’un homme, il recueille sa petite fille, âgée de deux ans et décide de l’élever. Parallèlement, il rencontre une femme dont il tombe amoureux…
Se déroulant à New-York, terrain d’exploration fétiche du réalisateur, tourné en seulement quinze jours, traitant du problème des sans-abris, « SIDEWALK STORIES » est une merveille.
Dans un noir et blanc limpide (bravo pour l’excellent travail de restauration), ce docu-fiction évoque irrésistiblement le «KID» de Chaplin et plus largement tout le cinéma muet en adoptant sa rythmique si particulière.
Pourtant, Charles Lane déclare dans les bonus, très instructifs, que si l’on pense à Charlot, ce n’est pas sciemment voulu et que la principale source d’inspiration vient du troublant « TIGER BAY » (« LES YEUX DU TEMOIN ») du sous-estimé J. Lee Thompson, une tragédie autour d’une fillette de 12 ans assistant à l’assassinat d’une femme par son compagnon polonais.
Captant avec acuité l’atmosphère si extravagante des « eighties », techniquement abouti (admirez le déplacement de ces corps inconnus), en dépit de quelques maladresses, avec un boulot sur le son prenant sens dans les ultimes minutes, voici un témoignage unique et vibrant sur un problème plus que jamais d’actualité.