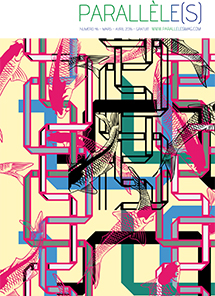NIGHT CALL
de Dan Gilroy (Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Riz Ahmed)

Le pouvoir des images et leur fascination ont donné quelques films d’importance, si ce n’est incontournables, du « BLOW-UP » d’Antonioni au «NETWORK» (ah, ce plan final) de Sidney Lumet en passant par « LA MORT EN DIRECT » de Tavernier et d’autres.
Nous restons près de 4 heures, chaque jour, devant nos postes de télé sans compter les autres écrans.
Nous sommes assaillis de représentations qui ont, probablement, quelques influences sur nos cerveaux et conditionnent une part de nos comportements.
Ceux qui les diffusent ont tout compris et se livrent à une surenchère.
Jusqu’où iront-ils ?
C’est un peu ce dont il est question dans « NIGHT CALL ».
Lou Bloom (Gyllenhaal), vivant de menus larcins, se découvre subitement une passion pour le journalisme sensationnel et décide de parcourir les rues de Los Angeles, à la recherche d’images choc pour les revendre ensuite aux chaînes de TV locales. Ayant un certain talent dans le domaine, il ne tarde pas à faire fructifier son business…
Venu du scénario (on lui doit le script du sympathique « REAL STEEL » avec Hugh Jackman), Dan Gilroy fait, ici, ses débuts derrière la caméra.
D’un sujet déjà maintes fois traité, il parvient pourtant à plonger le spectateur dans un thriller urbain assez immersif grâce à une ambiance nocturne saisissante – gros travail technique de Robert Elswit, le chef opérateur attitré de Paul Thomas Anderson – rappelant celle de « DRIVE » et surtout celle des premiers Abel Ferrara (les meilleurs) comme « DRILLER KILLER ».
Epaulé, de plus, par la formidable prestation de Jake Gyllenhaal (qui, après « ZODIAC », « PRISONERS » et « ENEMY », continue à choisir des rôles difficiles, s’éloignant des blockbusters décérébrés à la « PRINCE OF PERSIA » et renouant plutôt avec l’esprit de « DONNIE DARKO »), Gilroy fustige la libre entreprise américaine, cette notion de self-made-man, où tous les coups sont permis, par les agissements de Lou, glaçants, condamnables moralement mais autorisés de par la liberté d’expression, si puissante chez l’Oncle Sam.
Ce voyeurisme forcené cause des dégâts collatéraux et va jusqu’à remettre en cause l’intégrité journalistique d’une directrice de JT, incarnée par Rene Russo (« L’ARME FATALE 3 »).
On regrettera juste un manque d’approfondissement des liens entre les principaux protagonistes et leur background.
Quoi qu’il en soit, « the show must go on ».
THE SEARCH
de Michel Hazanavicius (Bérénice Bejo, Maxim Emelianov, Annette Bening)

1999, lors de la seconde guerre de Tchétchénie. Après l’assassinat de ses parents dans son village, Hadji, un enfant, erre sur les routes parmi les réfugiés du conflit. Carole, chargée de mission pour l’Union Européenne, se bat pour que la communauté internationale intervienne de façon efficace. Kolia, 20 ans, est enrôlé de force dans l’armée russe. Raïssa, elle, cherche son petit frère. Tous vont se croiser à un moment…
En dépit d’un remontage, enlevant vingt minutes par rapport à la version proposée à Cannes, difficile de sauver quelque chose dans cette fresque (sélectionnée incompréhensiblement en compétition officielle), si ce n’est une séquence d’ouverture fort bien exécutée.
Reprenant certaines situation des » ANGES MARQUES » (1948) de Fred Zinnemann, l’auteur de » THE ARTIST » est, hélas, incapable de faire ressentir la moindre empathie vis-à-vis de ses personnages et l’on reste consterné par certaines scènes, notamment celles réunissant Bérénice Bejo (Carole) et Abdul Khalim Mamutsiev (Hadji), tellement maladroites que cela en devient gênant.
Empruntant au » FULL METAL JACKET » de Kubrick concernant le parcours de Kolia, sans jamais atteindre un dixième de la charge psychologique décrite par le célèbre barbu solitaire, Hazanivicus, certainement sincère, n’arrive jamais à faire décoller son métrage et pêche par excès d’ambition.
Dans les fables de La Fontaine, je voudrais celle avec la grenouille…
ALLELUIA
de Fabrice Du Welz (Laurent Lucas, Lola Dueñas, Héléna Noguerra)

Défrayant la chronique aux Etats-Unis entre 1947 et 1949, Raymond Fernandez et Martha Beck, amants se faisant passer pour frère et soeur, coupables d’avoir assassiné au moins 20 femmes, devinrent bien vite des icônes au même titre, dans un registre moins sanglant mais tout aussi percutant, que Bonnie Parker et Clyde Barrow.
Il faudra cependant attendre près de 20 ans pour que le cinéma s’empare de ce fait divers avec le célèbre film de Leonard Kastle « LES TUEURS DE LA LUNE DE MIEL » en 1970.
Après quelques autres versions plus ou moins notables dont celle, superbe, d’Arturo Ripstein, c’est au tour maintenant de Fabrice Du Welz de proposer sa lecture de l’affaire avec « ALLELUIA ».
Gloria, infirmière dans un hôpital, fait la rencontre de Michel suite à une petite annonce. Coup de foudre instantané. Ils décident de prendre la route ensemble et d’arnaquer leur prochain. Mais leur amour absolu débouchera sur une passion meurtrière…
Dès la très courte séquence de pré-générique, on sait que nous sommes chez Du Welz, souvent décrié pour la violence inhérente à ses oeuvres.
Que ce soit avec le fort et poisseux « CALVAIRE », le tripant « VINYAN » ou le pas si mal « COLT 45 », il ne laisse point insensible à son univers, mélange de noirceur et de poésie toute personnelle, typique de certains auteurs venant du Plat Pays.
Notre ami belge, ici, se démarque des adaptations existantes, assez fidèles, concernant Fernandez et Beck en réalisant une oeuvre sans concession, foutraque, grotesque, anarchiste, surréaliste, aux développements narratifs parfois inaboutis (la relation unissant le couple assassin ne tient pas toutes ses promesses, faiblissant en cours de route).
On prend plaisir à retrouver Laurent Lucas, sous-utilisé généralement ou bien toujours pour les mêmes emplois inquiétants, donnant là une certaine fragilité et ironie à Michel (il faut l’entendre parler de chaussures des clients d’un restaurant) et l’Ibère Lola Dueñas ( » VOLVER « ), échappée un temps de chez Pedro Almodovar, en jalouse possessive.
Une étrangeté pour âmes endurcies.
CALVARY
de John Michael McDonagh (Brendan Gleeson, Chris O’Dowd, Kelly Reilly)

Le Père James officie dans une petite bourgade d’Irlande du Nord. Un mystérieux membre de sa paroisse, lors d’une confession, lui annonce qu’il va le tuer. Sa fille Fiona, habitant Londres et venant de faire une tentative de suicide, arrive pour se reposer. Tout en continuant à s’occuper des membres de sa congrégation, notre homme d’église tente de faire face à cette menace…
Singulier que l’univers cinématographique proposé par la famille McDonagh, car, que ce soit ici John Michael (précédemment le bancal « L’IRLANDAIS ») ou bien son frère, Martin (le trouble « BONS BAISERS DE BRUGES »), leurs «héros» sont des plus cocasses et les situations auxquelles ils sont exposés, également.
Ce « CALVARY » ne fait pas exception à la règle.
Dominée de la tête et des épaules par l’énorme Brendan Gleeson (« LE GENERAL »), acteur fétiche de nos frangins, cette comédie dramatique tente le pari de jouer sur les décalages pour créer de l’émotion.
Exercice casse-gueule s’il en est et qui ne pardonne pas.
Or, présentement, c’est gagné dans l’ensemble, car le metteur en scène sait ne pas s’appesantir sur les situations et permet même à une certaine poésie de l’absurde de s’installer.
Assumant son côté parfois « sketch », avec des dialogues de temps en temps incisifs et révélateurs d’un état d’esprit insulaire, ce deuxième long, en dépit de quelques tics visuels vers la fin, est touchant.
Du bel ouvrage.
ASTERIX – LE DOMAINE DES DIEUX (3D)
de Louis Clichy et Alexandre Astier (Avec les voix de Roger Carel, Guillaume Briat, Lorànt Deutsch)

D’après l’album éponyme de 1971, qui faisait déjà dans l’écologie.
Les Romains et l’architecte Anglaigus tentent de vaincre les Gaulois par la ruse en construisant des immeubles en pleine forêt pour y attirer la civilisation…
Respectant bien l’esprit caustique et politique de Goscinny, « ASTERIX – LE DOMAINE DES DIEUX » vaut principalement le détour pour la qualité de l’animation qui n’a pas à rougir par rapport à certains produits venant d’outre-Atlantique.
Cocorico.
L’affiche de la semaine : « FAR FROM THE MADDING CROWD » de Thomas Vinterberg
Prévu chez nous, en juin 2015, le nouveau Thomas Vinterberg, le cinéaste du sidérant « FESTEN » et de l’acclamé « LA CHASSE », est tiré d’un livre du romancier anglais Thomas Hardy, déjà magnifiquement adapté pour le grand écran par John Schlesinger en 1967 avec Julie Christie et Terence Stamp.
Au vu de l’affiche annonçant une grande passion amoureuse mouvementée (la brume et la fumée en arrière plan), du casting hétéroclite et de la propension de Vinterberg à malmener son monde, curieux de voir le résultat.