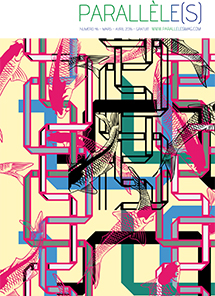UNDER THE SILVER LAKE (Compétition Officielle) (sortie prévue le 8 août)
de David Robert Mitchell (Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace)

Combien, parmi vous, avez eu la chance, à l’époque, de pouvoir visionner « THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER », sublime chronique adolescente sur ces fameuses soirées-pyjama ?
Sans doute pas beaucoup.
Ne vous tracassez pas, vous pouvez vous rattrapez, il est disponible en DVD.
Tout comme l’éblouissant « IT FOLLOWS », lui, plus médiatisé.
David Robert Mitchell – le responsable de ces deux films remarquables, présentés à la Semaine de la Critique – débarque pour la première fois en sélection officielle.
N’est-ce pas prématuré pour ce jeune auteur, tant l’on sait que la marche est difficile à atteindre et qu’un raté peut nuire pour l’après ?
Los Angeles. Sam, un adulescent résidant dans un appartement situé dans un lotissement avec piscine, passe ses journées à fumer sur son balcon et observer le voisinage. Un beau matin, il fait la connaissance de Sarah, une splendide nouvelle venue et passe l’après-midi en sa compagnie. Le lendemain, elle semble avoir quitté les lieux précipitamment et s’être volatilisée. Commence, alors, pour Sam, une quête délirante pour la retrouver…
C’est, à la fois, un long métrage riche et bancal.
Robert Mitchell instaure, avec ce thriller « conte de fées » une ambiance qui rappelle aussi bien Hitchcock – les références sont nombreuses et parfois plus qu’explicites – que David Lynch façon « MULHOLLAND DRIVE » – quelques degrés en dessous quand même.
Le hic, c’est qu’il ne parvient pas à conserver ce climat aussi immersif que probablement souhaité de sa part.
Car à force de courir plusieurs lièvres à la fois – et tout aussi passionnant soit-il à décortiquer les emprunts nombreux à la pop culture et le discours proposé à son égard – le cinéaste finit par ennuyer légèrement avec la pérégrination de son héros – Andrew Garfield épatant – qui n’en finit pas de s’étirer, multipliant les passages à « la manière de » – certains bien trouvés, d’autres hors propos.
Un objet trop foutraque pour remporter le morceau mais suffisamment curieux pour valoir le coup d’oeil.
SOLO : A STAR WARS STORY (Hors Compétition) (sortie prévue le 23 mai)
de Ron Howard (Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke)

– ‘Tain, t’as pas vu le dernier STAR WARS ?
– Tu veux dire le second spin-off, « SOLO » ?
– Ouais, c’est ça. Alors t’y étais ou pas à la projo d’hier soir ?
– Oui.
– Et donc ? Allez, crache le morceau. Beaucoup on trouvé ça tout pourri.
– Faut reconnaître que c’est pas terrible mais cela n’est pas non plus la catastrophe cosmique que beaucoup se complaisent à décrire.
Certes, aucun effort sur le scénario vu qu’il nous ressorte l’intrigue de « ROGUE ONE » en gros. On sait les problèmes de production – licenciement du duo Lord/Miller, responsable de l’hilarant « TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES », remplacé dans la tourmente par notre cher vétéran Ron Howard, capable du pire comme de l’exceptionnel.
Et ce dernier essaie de sauver les meubles comme il peut.
Passons sur les origines annoncées de Han Solo, elles n’y sont pas et Disney s’en contre-fout.
Humour piteux – l’origine du nom du futur pilote du Faucon Millénium – côtoie d’agréables séquences d’action – celle dans le maelstrom.
Défaut d’incarnation des protagonistes – seul Donald Glover dans le rôle de Lando Calrissian tire véritablement son épingle du jeu – mais vrai souci, hélas largement trop bref, de faire apparaitre des créatures old-school à la Jim Henson façon « DARK CRYSTAL » – la méchante du début – et de raconter une histoire comme au temps du grand Hollywood.
En fait, l’astuce pour sauver quelque petites choses de ce « SOLO : A STAR WARS STORY », c’est qu’il ne faut rien en attendre du tout.
THE HOUSE THAT JACK BUILT (Hors Compétition) (sortie indéterminée)
de Lars von Trier (Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman)

USA, années 70. Jack est un serial-killer invitant le spectateur à vivre, selon son point de vue, cinq épisodes marquants de son sanglant parcours…
On va être rapide car pas besoin d’en faire des caisses.
Déjà, incompréhensible les réactions des confrères internationaux qui crient au scandale – il en faut au moins un par édition – et jettent l’anathème encore une fois sur un Lars von Trier qui ne mérite pas tant de considération.
Celui-ci, revenant après une période cannoise de paria depuis ses propos litigieux datant de « MELANCHOLIA », aurait mieux fait de réfléchir.
En dépit d’un Matt Dillon habité, nous avons droit à un catalogue maladroit de citations empruntant notamment autant à Lautréamont qu’à de Thomas de Quincey, illustré par une mise en abîme – à travers le personnage de Jack – du propre parcours du metteur en scène danois.
Traversé par des passages violents où l’on tombe plus dans le grotesque – l’épisode des seins ou le puzzle ultime de corps – que dans la provocation utile et intelligente, « THE HOUSE THAT JACK BUILT » est un pétard mouillé de 2 h 35 qui n’en finit pas.
Au suivant.