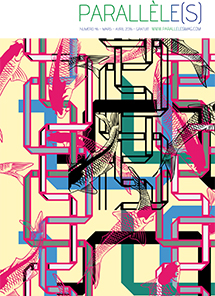SIN CITY 2 : J’AI TUÉ POUR ELLE
de Frank Miller et Robert Rodriguez (Josh Brolin, Eva Green, Mickey Rourke)

Les adaptations de comics, sur grand écran, déferlent régulièrement et nous en avons encore pour quelque temps.
Si la dernière fournée de l’écurie MARVEL, cet été, « LES GARDIENS DE LA GALAXIE », s’est avérée sympathique, cela commence néanmoins à sentir le produit uniformisé dans ses grandes largeurs.
Concernant DARK HORSE, dont le sigle est une tête de cheval noir, troisième éditeur américain de BD, derrière MARVEL et DC, il en est tout autre.
Que ce soit avec « THE MASK » qui révéla Jim Carrey au monde entier ou bien via «300» (le deuxième volet supérieur au premier), en passant par l’excellent « HELLBOY 2, LES LEGIONS D’OR MAUDITES » signée Guillermo Del Toro et en attendant l’arlésienne « THE GOON », beaucoup de différence, tant pour le meilleur que pour le pire.
Et puis, il y a, également issue de cette même compagnie, une autre franchise, au succès planétaire, qui connut un destin cinématographique : « SIN CITY ».
C’était en 2005.
Déjà, à l’époque, on parlait de révolution technique nécessaire, incroyable et tout ça, et déjà, à l’époque, l’auteur de ces lignes, avide lecteur de la production outre-Atlantique depuis bientôt trente ans, resta quelque peu circonspect sur le résultat.
Près d’une décennie plus tard, voilà que « SIN CITY 2 : J’AI TUÉ POUR ELLE » débarque aujourd’hui en salle.
Dans une ville putride est désepérée, plusieurs personnages vont se croiser. Marv (Mickey Rourke), une brute épaisse et redoutable combattant, veille sur Nancy (Jessica Alba), une danseuse du Kadie’s Club Pecos, qui ne se remet pas du suicide de son amoureux. Dwight McCarthy (Josh Brolin), un photographe minable, retrouve Ava Lord (Eva Green) qui hante ses rêves. Quant à Johnny (Joseph Gordon-Levitt), un as des cartes, il vient défier, au jeu, un sénateur véreux, son père…

Frank Miller, dessinateur, apporta, à l’orée des « eighties », une nouvelle façon de raconter les histoires dans le monde du comic book et de les mettre en image, essentiellement quand il officiait sur DAREDEVIL. Suivirent, pêle-mêle, RONIN, THE DARK KNIGHT RETURNS, 300 et, récemment, le contreversé HOLY TERROR.
Frank Miller, scénariste, c’est HARD BOILED pour Geoff Darrow, GIVE ME LIBERTY pour l’anglais Dave Gibbons ou encore BAD BOY pour ce punk de Simon Bisley.
Enfin, Frank Miller, réalisateur, c’est le catastrophique « THE SPIRIT » et, associé à Robert Rodriguez, dorénavant, ce second volet de « SIN CITY ».
Le premier avait, certes, le mérite d’utiliser la technologie pour retranscrire au poil de cul près les cases de la bande dessinée, mais il n’est pas interdit de n’y trouver aucun intérêt car lorsque que l’on parle d’adaptation, il est bon et salutaire d’apporter quelque nouveauté par rapport au matériau d’origine (« WATCHMEN » de Zach Snyder souffre, par ailleurs, du même problème).
Ici, on utilise trois arcs narratifs différents dont un, le principal, qui donne son titre au film, se déroulant avant les évènements du l’opus initial mais se trouve mélangé avec les autres, qui eux, se situent postérieurement. Pourquoi pas. Seulement, le manque de cohérence apparait trop flagrant, faute de palliatif, car nos deux loustics ont cru que le rythme, dans ce genre de projet, se devait d’être le centre névralgique. Solution envisageable, mais à condition de respecter un tant soit peu une logique de développement des péripéties, ce qui n’est aucunement le cas.
Le plus beau gâchis sera à mettre au crédit de la direction des acteurs car en dépit d’un cast somptueux (pratiquement le même qu’en 2005) et pourtant parfaitement choisi, aucun n’arrive à tirer son épingle du jeu à l’exception de Mickey Rourke.
La faute à cette volonté imbécile de Miller et Rodriguez de vouloir coller à tout prix aux expressions du comic, au détriment d’une liberté d’incarnation salvatrice qui aurait permis d’apporter un supplément d’âme aux divers protagonistes et une adhésion véritable à ce qui se déroule sous nos yeux.
Il faut voir Josh Brolin, crâne presque rasé apparaître d’un coup avec des cheveux, censé tromper son monde. Même Artémus Gordon, dans LES MYSTERES DE L’OUEST était plus crédible !
Eva Green, en femme fatale, et malgré ses seins nus, n’a aucun intérêt, à l’image de ce blockbuster laid.
Ami lecteur, reste chez toi.
Les autres, allez-y et faites-vous rembourser à la fin.
MANGE TES MORTS – TU NE DIRAS POINT
de Jean-Charles Hue (Frédéric Dorkel, Michaël Dauber, Jason François)

Fred, un yéniche, venant de sortir de prison, rejoint sa communauté. Pendant son absence, les choses ont changé. Jason, son demi-frère, est en pleine préparation de son baptême chrétien. Quant à Mickaël, le benjamin de la fratrie, il cherche à canaliser son comportement violent. Pour fêter leurs retrouvailles, ils partent en virée dans le monde extérieur, celui des étrangers, les gadjos…
En 2011, Jean-Charles Hue frappait un grand coup avec « LA BM DU SEIGNEUR », marquant ses débuts à la fabrication de long-métrage. Auteur auparavant de courts expérimentaux dans le monde des gitans, c’est un univers qui le fascine et qui lui rend bien. Nous faisions, alors, connaissance avec la famille Dorkel, que l’on retrouve ici.
Amenant une approche plus documentée et réaliste qu’un Gatlif qui ne peut s’empêcher, parfois, de tomber dans une espèce de mythologie de pacotille, Hue, avec « MANGE TES MORTS » (présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en mai) dresse un constat poignant, sans chichis, sur le quotidien des ces gens du voyage, entre rapines nécessaires et croyance en un avenir meilleur suivant leur façon de se comporter vis-à-vis de Dieu.
Ce qui impressionne surtout, c’est l’ensemble des comédiens non professionnels évoluant sous nos yeux avec leurs corps frèles ou énormes, tous majestueux.
Avec un naturalisme à la Pialat, associé à une énergie digne des premiers Bertrand Blier (certains des interprètes ont un charisme à la Dewaere), nous sommes en présence d’une ode magnifique à la liberté apparente, salutaire par les temps actuels.
Un « EASY RIDER » français.
Ni plus ni moins.
3 COEURS
de Benoît Jacquot (Benoît Poelvoorde, Charlotte Gainsbourg, Chiara Mastroianni)

Benoît Jacquot aime la littérature, nous le savons.
Mariveau en tête.
Ce que l’on sait moins, c’est sa passion pour John Stahl, immense cinéaste, encore trop injustement décrié, spécialiste du mélodrame hollywoodien dans les années 40 (sa version du « SECRET MAGNIFIQUE » vaut bien celle de Sirk).
Avec « 3 COEURS », Jacquot tente de concilier ce maître avec ses propres obsessions.
Marc (Benoit Poelvoorde), ayant raté son train pour retourner à Paris, se retrouve à devoir passer la soirée dans une ville de province. Croisant sur son chemin Sylvie (Charlotte Gainsbourg), ils discutent toute la nuit et se donnent rendez-vous, dans une semaine, à la Capitale, au jardin des Tuileries. Suite à un malheureux concours de circonstance, Marc ne pourra être présent alors que Sylvie, elle, avait fait le déplacement. En essayant d’aller à sa recherche, il fera la connaissance de Sophie (Chiara Mastroianni), sans savoir qu’elle est la soeur de Sylvie…
Fidèle à sa thématique des ravages que le sentiment amoureux peut provoquer chez l’être humain, le plus souvent en choisissant de l’observer chez la femme, l’auteur de « L’ECOLE DE LA CHAIR », cette fois, donne la place centrale à l’homme qui va se retrouver tiraillé entre deux choix distincts et difficilement conciliables.
Hélas, après un début réussi et malgré un Poelvoorde saisissant, la déception est au rendez-vous. La faute à un scénario tirant en longueur, manquant parfois de cohérence (certaines initiatives de Marc, travaillant aux impôts, sont difficilement compréhensibles telle l’attaque contre le maire) sans oublier des effets musicaux, un peu trop appuyés, annonçant les instants dramatiques et une voix-off incongrue.
Entre une Catherine Deneuve transparente et une Chiara Mastroianni peu concernée, même Charlotte est en deçà.
Le film en costumes convient nettement mieux au sieur Benoît (cf. « LES ADIEUX A LA REINE »), qui manque, là, de fluidité, et qui, d’ordinaire, fait preuve d’une autre conviction.
Le DVD de la semaine : « LE BOSSU DE LA MORGUE »
de Javier Aguirre / ARTUS FILMS

Il existe un cinéma fantastique français, quoiqu’en disent certains.
Il en existe un, anglais, devenu classique.
Il en existe, également un, italien.
Il en existe un, allemand et fondateur.
Mais, il en existe un autre en Europe, peut-être bien le plus florissant et délirant, qui vient d’Espagne.
Pour le prouver, ARTUS FILMS, éditeur DVD cher à nos cerveaux fievreux, vient de lancer une nouvelle collection, baptisée « CINE DE TERROR » avec trois titres, tous tournés pendant la période franquiste :
« LA MARIEE SANGLANTE » (1972) de Vincente Aranda où une jeune noble, fraîche épouse, commence à faire des cauchemars dans lesquels une femme en robe de mariée la pousse à commettre des actes violents et sanglants. Intéressant.
« LES VAMPIRES DU DR DRACULA » (1968) de Enrique Lopez Eguiluz. Avec un titre français idiot, surfant sur la vogue des suceurs de sang (le titre original « LA MARCA DEL HOMBRE-LOBO » est plutôt claire, non ?), cette formidable série B est considérée comme le début de l’âge d’Or du fantastique ibérique (auparavant, d’autres productions existaient, à l’instar de « LA TOUR DES 7 BOSSUS » en 1944 ou, évidemment, des débuts de Jess Franco, mais cela restait des phénomènes isolés). C’est surtout, pour les amateurs du genre, la première incursion de l’acteur culte Paul Naschy dans la peau de Waldemar Daninsky, démarquage habile du loup-garou crée par la UNIVERSAL en 41, et héros d’une longue et joli saga.
Et enfin, « LE BOSSU DE LA MORGUE » de Javier Aguirre.
Gotho, bossu de son état, travaille dans un hospice, à l’endroit où l’on range les cadavres. Soumis régulièrement aux vexations des étudiants en médecine, il aime en secret une patiente, atteinte d’un mal incurable. Lorsque cette dernière trépasse, fou de douleur, il kidnappe son corps dans le sous-sol de la morgue. La promesse d’un docteur de la ramener à la vie en échange de quelques services, va chambouler à jamais l’existence de notre malheureux handicapé…
Censé se dérouler en Autriche (le générique du début, très champêtre, est éloquent eu égard à l’atmosphère se dégageant par la suite), mais tourné intégralement au pays de la corrida, ce long convoque génialement différents genres : le thriller, l’horreur, le drame et la science-fiction.
Nous sommes en 1970. Le régime du caudillo est encore tenace même si de petits signes d’affaiblissement apparaissent. La censure règne et il faut, aux metteurs en scène, user de subterfuges, pour contourner les interdits. Seulement ici, nous nageons dans un tel délire, scénaristiquement parlant, – on mélange Frankenstein, Lovecraft, les romans à l’eau de rose, le gore… – que les ciseaux d’anastasie n’intervinrent pratiquement pas car l’entreprise était toute sauf sérieuse. Donc, ça pouvait passer. Cependant « LE BOSSU DE LA MORGUE » est plus fin que cela et Paul Naschy y trouve son plus bel emploi car, dans le rôle de misérable que la nature n’a pas gâté physiquement, il émeut, malgré des actes d’une violence inouïe. Plusieurs séquences sont d’anthologie notamment une, avec des rats, splendide.
Procurez-vous donc cette fournée, via des copies de bonne facture, agrémentée d’un livret passionnant dû à l’habituel Alain Petit, proposant un panorama du cinoche fantastique espagnol.
Fermez vite, maintenant, portes et fenêtres, car d’étranges créatures rôdent, avides de sang…