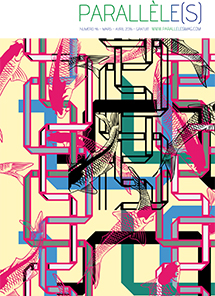AMERICAN BLUFF
de David O. Russell (Christian Bale, Amy Adams, Bradley Cooper)

Les escrocs ont toujours eu le vent en poupe dans le cinéma US car n’oublions pas que c’est le pays par excellence du self-made man où rien n’est impossible. Les classiques du genre sont connus et s’il fallait n’en citer qu’un, ce serait «L’ARNAQUE» (1973) de George Roy Hill avec le duo inoubliable Newman/Redford.
«AMERICAN BLUFF» en apparaît clairement comme le digne successeur mais avec un soupçon de «glam» et une bonne dose de paranoïa en plus.S’inspirant d’Abscam, une affaire célèbre en son temps qui défraya la chronique à la fin des «seventies» puisque l’on y voyait des malfaiteurs associés au F.B.I démasquant des hommes politiques aux agissements douteux, le cinéaste David O. Russell transcende son sujet tout en continuant d’explorer la thématique récurrente de son œuvre, celle de la place des marginaux dans notre société et de leur regard. Ici, le couple de filous, Irving Rosenfeld et Sydney Prosser, campés respectivement par Christian Bale et Amy Adams, brillantissimes, n’existent que par les yeux de l’autre et lorsque l’agent fédéral du bureau d’investigation, Richie DiMaso (Bradley Cooper, suave à souhait) les rejoint, formant ainsi un trio amoureux luttant contre le crime, tout se détraque.
Convoquant Pollack et Lumet, la force d’O. Russell, outre celle évidente d’aimer ses personnages, est de ne jamais céder à la facilité, d’éviter tout pathos inutile, même s’il le frôlait dans «HAPPINESS THERAPY», et ne pas donner les clés au spectateur, le laissant mariner.
Et puis quelle subtilité dans l’art d’exposition des traits de caractères! Seul petit bémol : Jennifer Lawrence, pas mal, mais un peu trop sacrifiée scénaristiquement, ne méritant pas son Golden Globe (contrairement à Julia Robert, repartie bredouille, pour «UN ETE A OSAGE COUNTY» mais nous y reviendrons lors de la sortie).
Qu’importe, voici un grand film, retors et fascinant, sur la psyché humaine dans toute sa complexité parfaitement bien traduite à l’écran dans une époque précise, celle des années 70.
Et surtout méfiez-vous des moments calmes où l’on croit que rien ne se passe car, en vérité, tout est là.
C’EST EUX LES CHIENS…
de Hisham Lasri (Hassam Ben Badida, Yahya El Fouandi, Jala Boulftaim)

En 1981, le Maroc fut la proie d’une révolte populaire, centrée à Casablanca, contre une baisse des subventions accordées aux produits de première nécessité et une augmentation brutale des prix sur l’huile, le blé, le beurre et la farine. Se transformant en véritable émeute, l’armée dut intervenir en réprimant violemment et de façon sanglante – usage de la torture et tirs à balles réelles sur les manifestants – cette vindicte. Bilan officiel, une centaine de morts (plus disent certains) et des milliers d’arrestations.
Majhoul, un membre actif de la manifestation d’alors, vient de passer trente ans dans les geôles marocaines. Errant dans les rues, lors du Printemps arabe, il ne tarde pas à attirer l’attention d’une équipe de télé en quête d’un sujet…
Surprenant à beaucoup d’égards, fort, poignant, enivrant, «C’EST EUX LES CHIENS…», d’Hisham Lasri, fait partie de ces œuvres pamphlétaires intelligentes qui dénoncent sans forcer le trait, à l’inverse d’un Costa-Gavras, même à son meilleur, période «SECTION SPECIALE».
Un mot sur l’acteur principal, Hassan Ben Badida, d’une humanité exceptionnelle.
Bénéficiant, hélas, d’une faible combinaison de copies (une cinquantaine), n’hésitez pas à menacer votre exploitant afin que celui-ci le programme dans ses salles, vous serez alors récompensés.
MEA CULPA
de Fred Cavayé (Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki)

Je vous avouerais que depuis l’excellent «LA PROIE» (2011) d’Eric Valette, la plupart des polars «made in France» ne m’ont guère convaincu.
Impressionné par la maîtrise de son premier thriller «POUR ELLE», en 2008, avec déjà Vincent Lindon et Diane Kruger, mais un chouïa déçu, malgré d’évidentes qualités par son second, «A BOUT PORTANT», (Gilles Lellouche en infirmier se transformant en avatar franchouillard de Jason Bourne, là non !), j’attendais néanmoins avec impatience le nouveau long-métrage de Fred Cavayé, un des talents les plus prometteurs dans le genre.
Suite à un accident de la circulation, Simon, flic sur Toulon, a sombré et est devenu convoyeur de fonds. Divorcé de sa femme Alice, il a du mal à tenir son rôle de père vis à vis de Théo, son fils de neuf ans. Son ami Frank, lui, toujours dans la police, veille à distance sur lui. Lors d’une corrida, Théo va malgré lui être témoin d’un règlement de comptes entre mafieux. Dès lors, la famille de Frank va se trouver en danger…
Ce solide suspense mâtiné de «buddy movie», l’humour en moins (malgré la présence de l’impayable Gilles Cohen en commissaire) fait plaisir à voir et prouve que lorsque l’on a un bon technicien derrière une caméra pour des scènes d’action efficaces et nécessaires au récit, ça paie cash !
RETOUR DE FESTIVAL : GERARDMER 2014.
Un des avantages quand on s’occupe de la programmation d’un festival international de cinéma, en l’occurrence, Mauvais Genre de Tours (www.festivalmauvaisgenre.com), c’est que l’on a pas besoin d’aller se peler le derrière dans les Vosges, à l’occasion du festival du film fantastique de Gérardmer car l’on a déjà pu mater la plupart des œuvres proposées.
Présidé par Jan Kounen, le jury, composé de Kim Chapiron, Juan Solanas, Béatrice Dalle, Alain Damasio, Roxane Mesquida, Tanya Raymonde et Roxane Mesquida, a rendu un palmarès équilibré et juste vis à vis d’une sélection autrement plus pertinente que celle de l’année passée (mais ce n’était pas difficile) et ce, malgré la présence de canards boiteux.
Commençons par eux.

Découvert lors de la quinzaine des réalisateurs à Cannes (déjà incompréhension totale), en mai dernier, «THE LAST DAYS ON MARS» de Ruairi Robinson mélange le film de science-fiction martien et le film d’infectés. Une équipe d’explorations du sol minier de la planète rouge découvre une bactérie nocive qui transforme l’espèce humaine en créatures avides de sang. Ce pitch pouvait laisser présager d’un survival sympathique et fun. Que nenni. Outre quelques jolis plans spatiaux, on se désintéresse rapidement de cette série B ne trouvant jamais sa vitesse de croisière et incapable d’exploiter les possibilités de son scénario certes basique mais propice à des scènes savoureuses. Au lieu de cela, nous sommes confrontés aux états d’âmes des principaux protagonistes dont on se contrefiche. Dieu que l’on trouve le temps long avec ce produit ni fait, ni à faire.
Autre purge, «ABLATIONS» d’Arnold de Parscau sur un scénario de Benoît Delépine ou comment un homme se réveille dans un terrain vague avec un rein en moins et va sombrer petit à petit dans la folie en voulant le retrouver, sacrifiant tout son entourage. Rien de bien charitable à en dire si ce n’est que trop de sérieux, parfois, tue.
Passons sur «WE ARE WHAT WE ARE» de Jim Mickle, découvert, lui aussi, à Cannes et m’ayant laissé de marbre. Etant un des seuls à penser cela de ce drame horrifico-religieux étatsunien ennuyeux d’un réalisateur surestimé comme son «STAKE LAND», please, pas de goudron et de plumes pour moi.

Marina de Van, via « DARK TOUCH », proposa, elle, après son insupportable «NE TE RETOURNE PAS», une digression fort intéressante et toute personnelle au «CARRIE» de Brian de Palma mâtinée d’une larmichette du «VILLAGE DES DAMNES». Une jeune fille, maltraitée et abusée, développe des pouvoirs psychiques effrayants et va se venger. Esthétiquement travaillée, avec une jeune actrice, Missy Keating à la présence certaine, ressemblant à Isabelle Adjani au même âge, voici une curiosité nihiliste pas toujours aboutie mais hautement recommandable qui sortira chez nous le 19 mars prochain.
Une des sensations du festival de Sundance 2014, «THE BABADOOK» de l’australienne Jennifer Kent a raflé le prix du jury (ex-aqueo avec le réjouissant «RIGOR MORTIS» de Juno Mak, véritable hommage au cinoche d’épouvante hong-kongais des années 80), le prix du public, le prix de la critique et le prix du jury jeunes. Mérité ? Oui et non. Disons que cette histoire de boogeyman hantant une mère célibataire et son fils est un peu l’équivalent du «MAMA» d’Andrés Muschietti de l’an dernier, également gagnant. Bien foutu mais pas révolutionnaire en soit.
Je ne pourrais vous dire ce que vaut «THE SACRAMENT» de Ti West ne l’ayant pas vu mais lauréat du prix du jury SYFY.

Terminons avec clairement le meilleur métrage de la compétition, «MISS ZOMBIE» de cet iconoclaste de Sabu (alias Hiroyuki Tanaka). Shooté dans un magnifique noir et blanc (avec une brève séquence en couleur), nous avons avons affaire à un remarquable drame fantastique, calme, proche parfois de l’expérimental, aux éruptions de violence salvatrices mais qui ne laisse pas indemne. Récipiendaire mérité du Grand Prix, ceci n’est aucunement, comme certains de mes confrères et amis du site ECRAN LARGE l’ont déclaré, une «faute de goût» mais bel et bien la reconnaissance d’un véritable talent.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur la hors-compétition où le niveau était bien moindre (l’affreux «DISCOPATHE», le décevant «ALMOST HUMAN» de Joe Begos…) mais la fatigue commençant à envahir votre serviteur, permettez que je prenne congé.