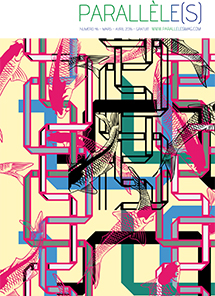SAMBA
de Eric Toledano et Olivier Nakache (Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim)

Près de 20 millions d’entrées pour « INTOUCHABLES ».
Triomphe imprévisible par tous et dont les raisons, que l’on aime ou non le film, sont explicables à postériori, du moins plus facilement que celles explicitant le carton de l’exécrable « LUCY » de Besson.
Qu’importe.
Autant dire qu’Eric Toledano et Olivier Nakache sont attendus de pied ferme avec « SAMBA », leur nouvel opus.
En France depuis dix ans, Samba, d’origine sénégalaise, enchaîne les jobs et prépare un diplôme pour travailler en cuisine. Essayant par tous les moyens d’obtenir ses papiers, il rencontre Alice, en pleine reconstruction après un burn-out, membre d’une association aidant les gens en situation irrégulière comme lui. Une relation naît entre eux, au développement inattendu…
Nakache et Toledano reprennent les mêmes recettes que leurs précédents films : des êtres que tout oppose et qui finiront par se comprendre et se rapprocher.
Dans « INTOUCHABLES », un riche paralytique et un banlieusard sortant de prison.
Dans « TELLEMENT PROCHES », un père absent et son enfant hyperactif, en demande.
Dans « JE PREFERE QU’ON RESTE AMIS… », un timide et un audacieux.
Abordant souvent les problèmes réels des communautés, soit par le rire, pas forcément fin (exemple la caricature des Juifs dans « TELLEMENT PROCHES », qui ferait passer « LES AVENTURES DE RABBI JACOB » pour un modèle d’élégance), soit par le tragi-comique qui fonctionne plutôt pas mal (« INTOUCHABLES »), notre duo, présentement, tape dans les sans-papiers.
Avec ce sujet, auparavant traité de façon plus dramatique, en particulier par Philippe Lioret avec « WELCOME », le tandem tente, là, d’émouvoir en faisant esquisser des sourires.
Louable intention mais, dans l’ensemble, c’est raté.
Associer Omar Sy et Charlotte Gainsbourg, sur le papier, l’idée est forte.
En réalité, entre une Charlotte jouant ENCORE sur le registre de la dépression, se forçant à péter les plombs et un Omar roulant des yeux, avec son air de chien battu et affublé d’une diction ri-di-cu-le, peu de choses à sauver d’un scénar maladroit qui se traîne en longueur.
Et les clichés, mes aïeux !
Pour nos compères, les gens, dans le métro parisien, voyant un Noir bien habillé, en costume, n’arrêteraient pas de le dévisager.
Arrêtons ces fantasmes d’un autre âge.
Alors il est vrai que nous avons droit à l’habituelle scène de danse où une légère émotion se dégage, mais qui retombe rapidement dans l’oubli.
Il y a, également, Tahar Rahim, lors d’une séquence de laveur de vitres en hauteur, amusante, mais ce ne sont que de minuscules moments trop isolés car même sur l’ensemble, le héros du « PROPHETE » est anecdotique ainsi qu’Izïa Higelin.
Y’a p’têt bon BANANIA, mais y’a pas bon SAMBA.
LE LABYRINTHE
de Wes Ball (Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Blake Cooper)

Un jeune adulte, Thomas, la vingtaine à peine, se réveille subitement enfermé dans un monte-charge, arrivé à destination. S’en extirpant, il découvre une grande plaine, entourée de quatre murs et peuplée d’une cinquantaine d’autres jeunes qui se sont organisés en société, envoyés là par ceux qu’ils appellent les Créateurs et qui les aident en leur fournissant du matériel. Tous n’ont aucun souvenir du monde extérieur. Chaque matin, la porte du même mur s’ouvre, révélant un labyrinthe géant peuplé de créatures mortelles et, chaque soir, elle se referme. Thomas, faisant d’étranges rêves, tentera de trouver la sortie de cet immense dédale…
Désirant surfer sur le succès de la saga « HUNGER GAMES », Hollywood multiplie les transpositions à l’écran de romans fantastiques à destination des teenagers.
Cela donne, généralement, des oeuvres insipides (« NUMERO QUATRE » de D.J Caruso, « SUBLIMES CREATURES ») voire consternantes (« LES AMES VAGABONDES » de Andrew Niccol ou « THE GIVER », qui sort le 29 octobre).
En revanche, « LE LABYRINTHE » s’avère une excellente surprise.
A cela, une raison : son metteur en scène.
Car Wes Ball fait partie des précoces doués.
En effet, depuis ses dix-sept ans, il a bossé dans les effets visuels, soit pour des productions indépendantes, soit pour de prestigieux documentaires sur l’espace.
Passant derrière la caméra, en 2002, il signe deux courts dont le joli « A WORK IN PROGRESS », sur la solitude d’une fillette cherchant des amis, mixant prises de vue réelles et animation.
En 2011, avec « RUIN », course-poursuite de 8 mn se déroulant dans un univers post-apocalyptique, entre un motard et un mini vaisseau-spatial, il tape dans l’oeil de la 20th Century Fox qui lui propose alors le bouquin de science-fiction de James Dashner, dont voici la première partie.
Certains d’entre vous ne manqueront pas de signaler qu’on en connaît, des talents prometteurs qui se sont fait avaler par la grosse machinerie californienne.
Certes, mais pas Wes Ball qui ravit son monde pour ses débuts au long.
Personnages charismatiques et bien interprétés par des acteurs de série télé, dont Dylan TEEN WOLF O’Brien, très bonne utilisation des décors dont ceux, impressionnants, du labyrinthe (renvoyant aux bunkers de la Seconde guerre mondiale), gros boulot sur le son accentuant l’ambiance générale de claustrophobie, hommage au pop-corn movie de qualité des années 80 tel « LES GOONIES », voici une formidable relecture futuriste de « SA MAJESTE DES MOUCHES ».
Oui, rien que ça.
LES BOXTROLLS (3D)
de Graham Annable et Anthonty Stacchi (Avec les voix de Isaac Hempstead Wright, Ben Kingsley, Elle Fanning)

Laïka, ce n’est pas que le nom de la célèbre chienne soviétique mise ne orbite autour de la Terre, ni celui d’un sympathique groupe britannique de post-rock. Non. C’est également celui de studios spécialisés dans l’animation en stop-motion (image par image), responsables déjà des superbes « CORALINE » et « L’ETRANGE POUVOIR DE NORMAN ».
Avec « LES BOXTROLLS », font-ils la passe de trois ?
Dans l’Angleterre victorienne, les habitants de la ville de Cheesebridge, intéressés uniquement par le luxe et les fromages qui puent, vivent dans la peur des Boxtrolls. Ces monstres vivant dans les égouts sortiraient la nuit pour leur voler leurs biens les plus précieux : les enfants et les fromtons. Winnie, l’héritière d’une des familles les plus distinguées de la commune, en faisant connaissance avec Egg, un enfant adopté et élevé par ces trolls souterrains, découvrira une toute autre vérité…
Malgré tout le travail technique apparaissant à l’écran, force est de constater que la sauce ne prend jamais. La faute au manque flagrant d’inspiration d’un récit convenu et jamais incarné, en dépit du look amusant des Boxtrolls.
Comme un Munster appétissant sans odeur.
Tout est là, sauf l’essentiel.
WHITE BIRD IN A BLIZZARD
de Gregg Araki (Shailene Woodley, Eva Green, Christopher Meloni)

Triste.
Oui, triste de constater qu’un auteur aussi essentiel que Gregg Araki fut relégué en mai dernier au Marché du Film et ne bénéficia même pas d’une place dans une des sections parallèles de la Croisette.
On se souvient, avec délice, de son hilarant « KABOOM » ayant au moins, lui, connu, justement, une séance de minuit mémorable en 2010 à Cannes.
Mais au regard de ce « WHITE BIRD IN A BLIZZARD », présenté à Sundance, ce purgatoire est-il bien légitime ?
Kat Connors (Woodley) est une ado américaine de 17 ans. Un beau matin d’hiver, sa mère, Eve (Green), femme au foyer, disparaît sans laisser de trace. Se retrouvant seule avec son père, Brock (Meloni), un directeur d’une petite entreprise, elle va, entre la naissance des premières amours et les sorties avec les copains, prendre progressivement conscience d’un manque…
Adaptant l’écrivaine et poétesse Laura Kasischke, le réalisateur de « MYSTERIOUS SKIN » poursuit inlassablement son travail d’entomologiste sur la jeunesse de la middle class états-unienne.
Bénéficiant d’un maigre budget – ce qui transparaît parfois à l’écran sans qu’il arrive à le camoufler entièrement – Araki prouve, cependant, qu’il possède toujours sa patte d’esthète si reconnaissable et prisée lors de scènes d’ambiance envoûtantes.
En livrant une tranche de vie colorée mais inégale, il aborde, avec gravité, un sujet qui parlera aux adolescentes du monde entier.
Et puis les comédiens osent : Eva Green, magnétique, joue délibérément avec son image, Shailene Woodley, bien loin de l’aseptisé « DIVERGENCE », étonne et Christopher Meloni s’avère impeccable dans un rôle pas si simple.
Vraiment, en dépit de quelques faiblesses, Gregg mérite mieux.
Faites-lui donc justice.
L’affiche de la semaine : « MR. TURNER » de Mike Leigh
Le biopic du célèbre peintre Turner, vu par Mike Leigh, sera dans nos salles le 3 décembre prochain.
Contrairement au métrage, décevant, l’affiche américaine est une splendeur !