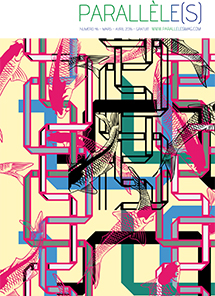MR. TURNER
de Mike Leigh (Timothy Spall, Dorothy Atkitson, Paul Jesson)

Mike Leigh n’est pas le cinéaste de la franche rigolade, tout le monde en conviendra, même si certaines de ses oeuvres flirtent avec, telle, dernièrement, « BE HAPPY ».
Ici, il entreprend de nous conter la vie adulte finissante du peintre britannique du XIXème siècle, J.M.W.Turner.
Entouré de son père et sa fidèle servante, Turner, artiste reconnu, fréquente l’aristocratie de son temps et voyage fréquemment pour nourrir ses inspirations créatrices. Son existence changera lors de sa rencontre avec Mrs Booth, la tenancière d’une petite pension de famille en bord de mer…
La première scène d’ouverture, magnifiquement picturale, promet énormément : des paysannes évoluent dans un champ sous la clarté naturelle tamisée du soleil, jouant sur le contraste comme dans un des tableaux du maître lui-même, génie du jeu des ombres et de la lumière. On pourrait même dire comme dans une toile de cette fameuse école flamande du XVIIème siècle, Vermeer en tête et avant lui Rubens.
Ce travail esthétique, sublime tout le long, une des qualités indéniables de ce métrage, est à mettre au crédit de l’excellent chef opérateur Dick Pope, déjà responsable, entre autres, des éclairages de « VERA DRAKE ».
Hélas, l’embellie sera de courte durée car Mike Leigh, en décidant de faire dans l’intime, très intime même, lasse.
Certes, il nous présente Turner (Timothy Spall, impressionnant, qui remporta le prix d’interprétation masculine à Cannes) comme un misanthrope, vieil ours mal léché s’exprimant par grognements – une fois, deux fois, ok, au bout de la troisième, la redondance devient pénible – sans doute proche de la véracité historique (qu’importe si ce n’était pas le cas), mais son passé est totalement occulté.
Dommage.
Car nous aurions aimé en savoir plus sur l’apprentissage de ce génie pictural – un ou deux flash-backs savamment distillés auraient suffi.
Non.
Pour le sieur Mike, et il est vrai que cela peut être une solution, nous sommes dans l’instantané où tout doit passer par les expressions des personnages, leurs gestes et l’apparition de leurs sentiments.
Seulement, la froideur de l’ensemble tue toute adhésion à ce procédé.
Les deux plans finals, superbes, de ce « MR.TURNER » nous font d’autant plus regretter son manque d’hétérogénéité.
PADDINGTON
de Paul King (Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Sally Hawkins)

Suite à une catastrophe naturelle détruisant son habitation, un ourson du Pérou, adepte de la marmelade, traverse les océans et se rend à Londres afin de retrouver l’explorateur qui rendit visite à sa tribu bien des années auparavant. Là, il tombera sur la famille Brown qui l’aidera dans ses recherches et essaiera de le protéger d’une dangereuse taxidermiste…
Né, en 1958, de l’imagination de Michael Bond, écrivain de littérature pour la jeunesse et véritable institution au pays de sa très gracieuse majesté (une statue lui est même consacrée dans la station de métro londonienne qui lui donna son nom), « PADDINGTON » a été adapté pour le grand écran par Paul King et le résultat débarque chez nous aujourd’hui.
Ce dernier, spécialiste de séries TV comiques anglaises (l’hilarante et surréaliste THE MIGHTY BOOSH) signe un très bon divertissement, rigolo et tendre, où chacun, petits comme grands, aura son content.
Les plus jeunes, un animal héros gaffeur et magnétique (bluffante animation du personnage) qui les ravira.
Les plus anciens, des allusions au racisme et la présence de Nicole Kidman, savoureuse, en empailleuse névrosée.
On vient cependant d’apprendre que le bureau britannique de classification des films (la censure, quoi) y a décelé de «légères références sexuelles», des écarts de langage ainsi qu’un comportement à risque de la part de l’ours car on le voit faire, à un moment, du skate à l’arrière d’un bus (lors d’une séquence particulièrement réussie par ailleurs).
Du coup, ils ont mis une interdiction au moins de dix ans, sauf avec accord parental.
Je vous rassure, françaises, français, vous pouvez y emmener en toute quiétude vos chères têtes blondes.
Au pire, ells voudront, après coup, se goinfrer de marmelade.
Au mieux, elles vous remercieront.
LA FRENCH
de Cédric Jimenez (Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette)

La « French Connection », késako ?
Simplement la plus grosse industrie mafieuse liée au trafic de drogue, opérant dans les années 70, principalement dans la cité phocéenne, et exportant la quasi totalité de l’héroïne alors consommée aux Etats-Unis.
C’est également un «classique» du thriller que William Friedkin réalisa juste avant « L’EXORCISTE ».
Centrée sur les évènements qui menèrent à l’assassinat du juge Michel en octobre 1981, en voici une libre interprétation.
Marseille. 1975. Pierre Michel (Dujardin), magistrat impétueux, auparavant chargé des affaires de mineurs, est nommé juge du grand banditisme. Se rendant compte de la mollesse de la lutte contre les dealers, il va alors user de méthodes musclées pour mettre un terme aux agissements de Gaëtan Zampa (Lellouche), le plus puissant des parrains de la Côte…
S’il y a bien un genre dans lequel nous avons excellé dans l’Hexagone, c’est bien le polar.
Deray, Melville, Verneuil, Enrico, Giovanni, en sont les plus éclatants exemples.
Depuis eux, régulièrement, des tentatives plus ou moins imparfaites mais rarement concluantes, à l’exception de quelques-unes comme « LES LYONNAIS » d’Olivier Marchal.
Cédric Jimenez, déjà responsable de l’inabouti mais intéressant « AUX YEUX DE TOUS », possède la qualité de savoir trousser assez efficacement des scènes d’action.
En revanche, lors des moments «calmes» c’est beaucoup plus hasardeux, voire laborieux.
Louable est son intention de proposer une fresque à la fois intimiste et spectaculaire, mais encore faut-il savoir le faire.
Car malgré un soucis d’authenticité (les décors exacts où se déroulèrent les différentes actions, les costumes), difficile de se sentir concerné par ce qui se déroule sous nous yeux, faute d’un traitement quelque peu original..
Le parcours des protagonistes est archi balisé et malgré la conviction dont font preuve Jean Dujardin (qui a du mal, décidément, dans le registre sérieux) – la scène consternante de la cabine téléphonique – et Gilles Lellouche (un peu caricatural), on s’ennuie poliment.
Seul Benoît Magimel, dans un petit rôle, tire son épingle du jeu.
« LA FRENCH » manque cruellement de chair.
N’est pas Francis Ford Coppola qui veut.
LES HÉRITIERS
de Marie-Castille Mention-Schaar (Ariane Ascaride, Ahmed Drame, Noémie Merlant)

Une enseignante de banlieue (Ariane Ascaride) doit s’occuper d’une classe de seconde au niveau très faible. Elle décide, envers et contre tous, de les inscrire au Concours international de la résistance et de la déportation. Ses elèves, considérés comme irrécupérables, révélent des qualités insoupçonnées…
Inspiré d’une histoire vraie, « LES HÉRITIERS » de Marie-Castille Mention-Schaar (le sensible « MA PREMIÈRE FOIS » et le poussif « BOWLING ») est difficilement critiquable sans risquer de passer derechef pour un sans-coeur, car hormis les jeunes comédiens, charismatiques, Ahmed Drame en tête, force est de constater une avalanche de bons sentiments où tout le monde il est bien, tout le monde il est gentil.
Sensation curieuse d’avoir assisté à une longue pub sponsorisée par l’Éducation nationale.
Le DVD de la semaine : « MISTER BABADOOK »
de Jennifer Kent / WILD SIDE

Revenant sur le devant de la scène internationale depuis une décennie, confére le succès de « WOLF CREEK », le cinéma d’exploitation australien, depuis, alterne le médiocre (« THESE FINAL HOURS » de Zak Hilditch, sur l’imminence de l’Apocalypse, « WOLF CREEK 2 »), le correct (« SOLITAIRE » sur un crocodile géant) et l’excellent (« COFFIN ROCK » de Rupert Glasson, variation du « THEOREME » de Pasolini).
En plus, bientôt, sonnez tambours et trompettes, nous aurons droit à un « MAD MAX : FURY ROAD » qui s’annonce grandiose, vu que d’une part, il est exécuté par George Miller, le papa de la saga et excellent metteur en scène (« LES SORCIERES D’EASTWICK », « HAPPY FEET ») et que de l’autre, c’est Tom Hardy (« BRONSON ») qui endosse le costume.
WILD SIDE, éditeur de DVD au catalogue riche mais inégal, vient de sortir une des sensations de SUNDANCE 2014, multi-récompensée dans la foulée au festival de GERARDMER, « MISTER BABADOOK » de Jennifer Kent.
Suite à un accident de voiture qui coûta la vie à son mari, Amelia a élevé seule Samuel, son garçon turbulent de 6 ans, souvent incontrôlable et en proie à d’effroyables cauchemars. Un jour, elle découvre un livre de contes sur une étrange créature, le BABADOOK et en fait la lecture à son fils. Celui-ci persuadé qu’il s’agit du monstre qui hante ses rêves, devient violent et, bientôt, une présence maléfique se fait sentir dans la maison…
Renonçant à tous effets numériques et privilégiant ceux à l’ancienne, Jennifer Kent, avec une maestria impressionnante pour son premier long, livre l’un des meilleurs morceaux de fantastique de l’année (financé grâce au crowdfunding).
Usant de cadrages ingénieux et subtils pour mieux provoquer l’angoisse et la l’effroi (Jacques Tourneur n’est pas très loin), elle dresse avant tout une douloureuse histoire d’amour entre une mère et son enfant, campés respectivement par l’impeccable Essie Davis (la Maggie de « MATRIX REVOLUTION ») et l’étonnant Noah Wiseman, au visage particulier, débutant sous les sunlights et qui hésite, constamment et sciemment, entre la parfaite tête à claques et le petit ange.
Il s’agit également d’une réflexion pertinente sur nos peurs les plus profondes et comment les apprivoiser, prenant tout son sens dans l’ultime quart d’heure.
Côté bonus, « MONSTER », le prenant court métrage en noir et blanc, rappelant David Lynch, de Jennifer Kent et qui lui donna l’idée de « THE BABADOOK » (titre en vo) et un entretien instructif avec elle.
Après le « JUSQU’EN ENFER » de Sam Raimi, voici un nouvel exemple que c’est « dans les vieux pots que l’on fait la meilleure soupe », à condition d’avoir du talent, du courage et la foi.